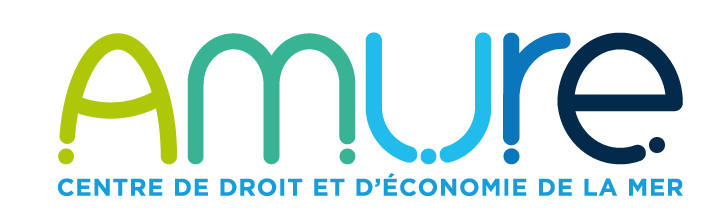Le 11 septembre 2025, Monsieur Alban LANDRE soutiendra ses travaux de thèse en sociologie portant sur :
« Renégocier le pouvoir sur la terre. Les conséquences des acquisitions de parcelles à usages agricoles par le Conservatoire du littoral »
Ce travail a été mené sous la direction de Céline Granjou et Alix Levain, grâce aux financements du Conservatoire du littoral et de l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) dans le cadre d’une convention CIFRE. Il a été préparé à la délégation Bretagne du Conservatoire du littoral, dans l’unité mixte de recherche AMURE (UBO/Ifremer/CNRS/IRD, Brest) et dans l’unité de recherche LESSEM (INRAE, Grenoble).
Résumé :
La propriété publique suscite des espoirs d’écologisation de l’agriculture, comparativement aux politiques incitatives et au droit. Une thèse CIFRE auprès du Conservatoire du littoral a permis de jauger les capacités de cet établissement public à mission foncière et naturaliste à transformer l’agriculture. Le Conservatoire intervient de plus en plus sur des sites marqués par les grandes cultures (céréales, légumes). L’établissement élargit ainsi les types de milieux dont il se charge alors qu’il se concentrait historiquement sur des paysages emblématiques et des habitats remarquables afin de concilier leur préservation et leur fréquentation. Le protocole de recherche s’est déployé autour de la Baie de la Fresnaye (Côtes d’Armor), de l’Anse du Guillec (Finistère), des Caps Blanc-Nez et Gris-Nez (Pas-de-Calais) et du Lac de Madine (Meuse et-Meurthe-et-Moselle). Le corpus a été constitué par l’exploration d’archives, des observations ethnographiques (notamment un an d’immersion dans une équipe du Conservatoire) et des entretiens semi-directifs (avec des agriculteurs, élus communaux et professionnels de la protection de l’environnement et d’organisations agricoles).
Le manuscrit contribue à la sociologie de l’environnement et de l’écologisation. Sur les quatre sites d’étude, les agents du Conservatoire rencontrent des difficultés à déployer la préférence naturaliste et pratique de l’établissement pour la prairie permanente. La nécessité d’obtenir l’autorisation des conseils municipaux pour acquérir des parcelles pousse les agents de l’établissement à proposer d’autres voies d’évolution : implantation de bandes enherbées, talus et haies, allongement et diversification des rotations de cultures. Une contrainte d’agricolisation transforme les missions des agents du Conservatoire, par la croissance du temps de travail administratif et de médiation dédié à l’agriculture. L’agricolisation se traduit par un autre défi : assumer localement que des acquisitions publiques et des objectifs naturalistes viennent ébranler l’ordre agricole. En effet, les acquisitions et les contractualisations sur le futur des parcelles bousculent l’évidence et la légitimité de l’ascendant des agriculteurs sur les transactions et les usages des terres cultivables. Le premier apport principal du manuscrit est une typologie des épreuves propriétaires qui ont lieu lorsque le Conservatoire transforme les baux ruraux en conventions de droit public afin d’encadrer les usages. Cette typologie fait ressortir que le Conservatoire ne peut imposer son pouvoir naturaliste sur le futur des terres que lorsque qu’il n’y a pas ou plus d’agriculteur-usager en place (retraite). Dans les autres cas, la propriété publique contraint à discuter et pousse les agriculteurs et les agents du Conservatoire à s’entendre. C’est le deuxième apport principal de la thèse. Les acquisitions publiques déplacent les oppositions production-protection classiques vers une échelle fine (la parcelle) et une temporalité longue (celle de relations de gestion à propos de terres que les agriculteurs ne pourront jamais acquérir). Plutôt que d’imposer mécaniquement un ordre environnemental, la propriété publique favorise donc la renégociation progressive du partage des pouvoirs sur la terre.
Mots-clés : Conservatoire du littoral ; agriculture ; protection de l’environnement ; écologisation ; agricolisation ; propriété publique.
Composition du jury :
– Jérémie Forney | Professeur ordinaire – Université de Neuchâtel – Anthropology Institute (rapporteur)
– Fabien Girard | Professeur des universités – Université Grenoble Alpes – CRJ (examinateur)
– Céline Granjou | Directrice de recherche – INRAE – LESSEM (directrice de thèse)
– François Léger | IRHC Ministère de l’Agriculture/Enseignant-chercheur – AgroParisTech – ESE (invité)
– Alix Levain | Chargée de recherche – CNRS – AMURE/POSSEA (co-directrice de thèse)
– Léo Magnin | Chargé de recherche – CNRS – LISIS (examinateur)
– Romain Melot | Directeur de recherche – INRAE – BAGAP (rapporteur)
– Blandine Mesnel | Maîtresse de conférences – Université Paris-Panthéon-Assas – CERSA (examinatrice)
Jeudi 11 septembre 2025
à 14h
Centre INRAE de Grenoble,
2 rue de la Papeterie,
Saint martin d’Hères